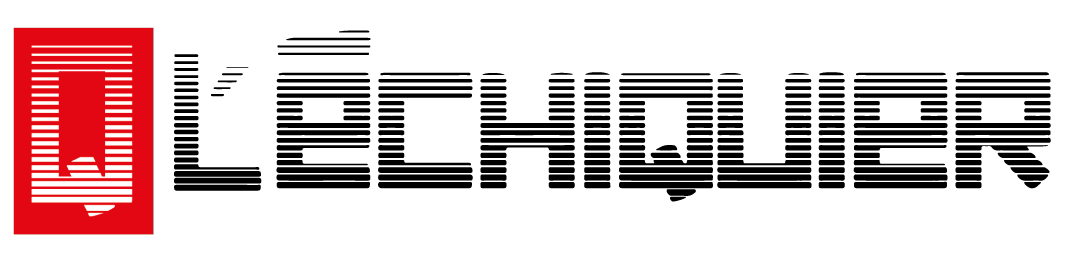Le putschisme providentiel
La fascination des masses et de certains milieux intellectuels africains pour les nouveaux putschistes en Afrique de l’Ouest, se décline comme le visage infantile et infantilisant de l’afro-radicalisme, une pathologie des Etats faillis, selon notre Radjoul Mouhamadou.
L’amertume démocratique qui gagne les pays francophones d’Afrique de l’Ouest – en transition pour la plupart depuis la chute du Mur de Berlin – s’est retournée, sous fond de pourrissement de la situation politique, économique et sécuritaire, en forte adhésion populaire aux récents renversements de régimes civils par des juntes militaires au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Une certaine ironie semble à l’œuvre dans ce retournement vertigineux des valeurs qui amène à percevoir désormais les coups d’État comme salvateurs et à préférer les promesses de stabilité venant de militaires qui proposent de sous-traiter la sécurité de la sous-région à la Russie poutinienne (et à ses mercenaires) aux régimes de transition démocratique moribonds certes mais garantissant certaines libertés civiles. En clair, les couches populaires, échaudées par ce qui est perçu à tort comme de l’apathie de la part des gouvernements civils face au péril existentiel que représente la contagion sous-régionale de la crise sécuritaire dont le Mali est l’épicentre, se laissent tenter à nouveau par les douces sirènes d’un certain “putschisme providentiel”. Ainsi, malgré l’inquiétant jeu de chaise musicale au sein de la junte burkinabé, succédant au renversement du président Roch Marc Kaboré le 24 janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré, ont bénéficié chacun à son tour d’un état de grâce populaire qui ferait pâlir d’envie des dirigeants démocratiquement élus. En présumant de l’incapacité des régimes civils à faire la guerre, l’on avait vanté les mérites martiaux du lieutenant-colonel Damiba et sa fine connaissance théorique des « formes bâtardes de terrorisme ». L’on peut à présent parier qu’avec la licence en géologie fondamentale et appliquée du capitaine Traoré, le Burkina Faso devrait bientôt trouver du pétrole, s’il maintient le rythme de la descente. Une large part de cette subversion de la démocratie, signant la revanche des militaires putschistes sur les alternances électorales qui les avaient peu à peu évincées du pouvoir depuis le début des années 90, est imputable à l’impéritie dans la gouvernance des affaires publiques et à l’échec global de ces alternances politiques civiles à l’épreuve du pouvoir. En guinée, par exemple, le renversement du président Alpha Condé le 5 septembre 2021 par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya avait été acclamé unanimement par la classe politique de l’opposition et la société civile au nom de la mauvaise gouvernance économique du pays et de la dérive autoritaire du président déchu. Comme le cas de la Guinée l’illustre dramatiquement, le désenchantement est amplifié par la défection démocratique des figures emblématiques comme Abdoulaye Wade, Alpha Condé, ou Alassane Ouattara, qui, après avoir suscité de grosses attentes, ont toutes cédé à la tentation du troisième mandat. Dans cette conjoncture favorable, les apprentis sorciers de la gâchette se sont convertis en habiles bretteurs rhétoriques prenant des accents démocratiques, populistes, nationalistes et souverainistes, pour flatter les passions tristes et les désirs frustrés d’alternative, afin d’écarter la concurrence. Et la supercherie marche !
Exacerbation du sentiment anti-français
Ainsi les nouvelles juntes militaires d’Afrique de l’Ouest francophone doivent leur popularité insolente à l’exacerbation du sentiment antifrançais latent ainsi qu’à une certaine sankaramanie renaissante. Attardons-nous un instant sur cette dernière dimension. Telle qu’elle se donne à observer, la sankaramanie est une martyromanie détournée, c’est-à-dire une pratique occulte du martyre de Thomas Sankara, un penchant de ses adeptes à vivre dans l’espérance extatique de sa réincarnation qui les rend particulièrement sensibles aux discours de récupérateurs qui se font passer pour des héritiers. Au fond, tout cela repose sur l’attente eschatologique du retour voire de la réincarnation physique du leader de la révolution burkinabé, poussant à voir l’ombre de Thomas Sankara sous l’apparat et le clinquant de chaque uniforme d’officier. Concrètement, cela se traduit pour les nouveaux putschistes, afin de mettre le peuple dans leur camp, par deux types de manipulations. Ils s’auréolent pour les uns de “cryptosankarisme” (sankarisme inavoué) ou de “cleptosankarisme” (sankarisme approprié indûment) pour les autres, sans s’en réclamer ouvertement dans les deux cas, en mimant ou en empruntant des codes discursifs parfois même vestimentaires qui ont tissé la légende de Thomas Sankara. Des messages subliminaux sont envoyés aux masses africaines, vivant dans le mythe de la réincarnation du capitaine flamboyant, pour s’assurer de rencontrer des adhésions enthousiastes, avant que la fausse réincarnation ne tourne presque toujours en farce ou en tragédie.
Après quatre décennies de notaires avancées démocratiques, l’Afrique de l’Ouest francophone a renoué avec l’apparition de phénomènes morbides dans le sillage de la crise malienne dès 2012. Du capitaine Amadou Sanogo au colonel Assimi Goïta au Mali, du colonel Moussa Dadis Camara au lieutenant-colonel Mamady Doumbouya en Guinée, la sous-région embarque résistiblement sur la “nef des fous”. Il est même arrivé qu’un sosie grossier de Machin La Hernie, du nom de ce personnage loufoque du théâtre politique de Sony Labou Tansi, transforme la vie politique guinéenne en télé-réalité haletante et divertissante à certains égards ; avant que toute cette farce ne dégénère en tragédie avec les viols massifs de femmes par des militaires dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. Fin du Dadis Reality TV Show et retour brutal à la réalité. Les juntes militaires, faut-il encore le rappeler, sont des machines à décevoir. Mais dans ce curieux jeu de l’offre et de la demande politique, l’instrumentalisation de la figure de Thomas Sankara se révèlera doublement efficace pour tout militaire tenté par l’aventure en politique, car clepto/cryptosankarisme et sankaromanie interagissent de façon harmonieuse, inodore et insipide sous les dehors d’une pratique occulte du martyre afin d’apporter une légitimité populaire à des coups d’État ainsi promis à la dignité d’actes salvateurs.
À première vue, l’hypothèse que je viens d’articuler peut paraître audacieuse voire provocatrice, mais elle se défend très aisément. Le double dévoiement du parcours “exceptionnel” de Thomas Sankara, ainsi que cela a été montré plus haut, favorise l’implantation de régimes autoritaires d’un nouveau genre en Afrique de l’Ouest : un populisme autoritaire qui se prévaut d’un charisme démocratique justifiant le ralliement cultuel derrière le chef de la junte contre les ingérences et les ennemis extérieurs. Une fois cela énoncé, il convient de faire une distinction entre sankaramanie et sankarisme. La sankaramanie est une forme d’idolâtrie politique à la fois occulte et inculte, alors que le sankarisme suggère qu’il existerait une idéologie propre à Thomas Sankara. Quitte à doucher d’emblée les velléités d’éventuels sankaralogues, il n’y a pas de doctrine politique propre à Thomas Sankara pouvant fournir la consistance d’une idéologie politique. La sankaramanie, par excès de zèle inculte, s’excepte de tout recul critique vis-à-vis de la vie et des actions réelles de ce dernier comme cela sied à toute construction mythologique et mystificatrice. Elle n’est qu’un état d’esprit généralisé, une prédisposition collective, une adhésion naïve à la figure d’un chef militaire charismatique, qui, expose désormais les pays d’Afrique francophone aux pires récupérations malhonnêtes et instrumentalisations corruptrices, dont la première victime est l’icône de la révolution burkinabé elle-même. Prenons un instant pour faire une évaluation critique mais non exhaustive de l’héritage politique de celui qui fut à la tête de la révolution au Burkina Faso de 1983 jusqu’à sa chute en 1987, pour tenter de l’arracher aux appropriations antidémocratiques. Thomas Sankara fut une météorite, à la fois au Burkina Faso (neuf putschs à ce jour dont un seul déboucha sur une révolution plus ou moins populaire) et en dehors. À ce jour, seul le putsch du « flying lieutenant » Jerry Rawlings au Ghana a accouché d’une démocratisation durable en Afrique de l’Ouest.
À son corps défendant, la figure de Thomas Sankara est devenue un levier de consentement à l’autoritarisme et une jauge servant à mesurer « l’obéissance anticipée » (Timothy Snyder) des populations aux coups de force, renseignant les aspirants putschistes sur la manipulabilité et l’adhésion possible des populations à des régimes autoritaires favorisant la restriction des libertés. Ces derniers se pareront d’un clepto/cryptosankarisme qui leur octroiera une part de l’aura de Thomas Sankara, en feignant d’inscrire leurs pas dans les bottes de l’illustre capitaine. Aussi, ils peuvent compter sur la crédulité sankaromaniaque qui disposera favorablement les populations à des régimes militaires trop heureux de pouvoir se draper dans un parfum révolutionnaire, panafricain, subversif, etc. Paradoxalement, le sankarisme est la meilleure arme contre la sankaromanie ainsi que le clepto/cryptosankarisme. Abstraction faite des vernis marxiste, féministe et tiers-mondiste dans l’air du temps qui saupoudraient ses harangues, pour le dire proprement, l’on doit se rendre à l’absence d’un corpus cohérent d’idées et de pratiques spécifiques qu’on pourrait qualifier de « doctrine » politique de Thomas Sankara. De ce point de vue, le sankarisme est un style et non une idéologie. Un style populiste et un incroyable aplomb, empreint du panache et de la témérité qui ont marqué son modèle de gouvernement. Au fond, il n’y a rien à hériter ou à singer de l’épopée, de la geste et de l’éthique du sacrifice de Thomas Sankara, à part peut-être l’encouragement à poursuivre l’idéal de l’Émancipation avec d’autres moyens. Sans la mort héroïque qui en fit un martyr de la cause des peuples africains, il n’aurait pas échappé à l’usure du pouvoir. D’ailleurs, peu de temps avant son assassinat, la déception des attentes et le refroidissement des enthousiasmes avaient commencé à se faire sentir, car la propagande révolutionnaire, la démocratie en treillis et le développement à marche forcée avaient atteint leurs limites. Le linceul du martyr a, par la suite, interdit toute évaluation critique des quatre années (1983-1987) d’expérimentations révolutionnaires au Burkina Faso. L’heure est au devoir d’inventaire. La pratique inculte du martyr des dernières décennies ne devrait pas effacer l’homme et son bilan derrière le mythe et la mystification. L’on ne peut désormais plus en faire l’économie, surtout parce qu’il faut situer Sankara dans son contexte d’avant la Chute du mur de Berlin pour mieux le comprendre. Hors de cet âge d’or du tiers-mondisme et de la fascination révolutionnaire, il ne demeure qu’un spectre qui hante nos temps de transitions démocratiques en Afrique francophone. Le pouvoir hypnotique de son charisme servait de levure à un projet de société révolutionnaire qui ne rechignait pas à la force pour imposer sa vision de la justice sociale, tout en se réclamant d’une tiède démocratie participative dirigée d’une main de fer. Bien qu’il ait déclaré qu’« on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées », Thomas Sankara n’était pas à une contradiction près : il pouvait s’exclamer « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ! » tout en contrôlant la presse et en faisant enfermer certains de ses opposants ; il eut maille à partir avec les partis politiques et les syndicats, etc. Lors du 4ème anniversaire de la révolution, il reconnut des erreurs devant justifier l’inflexion de certaines orientations prises par la révolution burkinabé. Mais il n’eut point le temps de s’y atteler. Au demeurant, peut-on parler de révolution véritablement populaire, alors qu’il est venu au pouvoir à la faveur d’un putsch de militaires ? Thomas Sankara est définitivement un personnage historique difficile à arracher à son contexte historique.
Le sankarisme, une variante du bonapartisme
D’un certain point de vue, le sankarisme se comprend comme une variante de ce bonapartisme tropical dont n’importe quels caporal, capitaine ou colonel s’autorisait pour légitimer un putsch. Le bonapartisme tropical s’entend ici comme l’attachement à un pouvoir exécutif autoritaire et centralisé investit a posteriori par plébiscite ne renonçant pas complètement aux valeurs républicaines et entretenant l’illusion de consultations électorales. Il connut différentes traductions aux antipodes les unes des autres sous nos tristes tropiques politiques: celle purement parodique de l’empereur sans Empire Jean-Bedel Bokassa qui se fit couronner en Centrafrique ; celle plus pragmatique de Thomas Sankara qui donna des couleurs locales au volontarisme politique et à la gestion autoritaire ; celle très symbolique d’un Gnassingbé Eyadema ne se bornant qu’à l’évocation des similitudes biographiques – à savoir de l’ascension de militaires de métier à la faveur de putschs à la tête de leurs pays.
Nous devons, pour conclure, notre état contemporain de confusion au vacillement des promesses des régimes de transition et à l’infléchissement collectif des principes qui font le sel de l’idéal démocratique. Deux exemples peuvent être convoqués à l’appui de la présente proposition. Les turpides de l’écrivain guinéen Tierno Monénembo depuis la chute d’Alpha Condé, qui, mieux que quiconque aurait dû être vacciné contre les juntes militaires par le règne bouffonesque de Dadis Camara qui a érigé le “soap opera” en mode de gouvernement, sont symptomatiques à plusieurs titres de la confusion ambiante. Dans un premier temps, il céda aux charmes du fringant lieutenant-colonel aux lunettes noires, Mamady Doumbouya, pour avoir débarrassé la Guinée du régime grabataire d’Alpha Condé ; avant de se raviser quand celui entrepris la réhabilitation de l’ancien président Sékou Touré. Mais pourquoi, après avoir connu les régimes de Lansana Conté et de Dadis Camara, toujours attendre le moindre changement démocratique d’un régime militaire en Guinée ? Qu’à cela ne tienne, le camarade Tierno Monénembo, après s’être mis au garde-à-vous pour saluer le « putsch providentiel » a retrouvé sa verve contre la décision du « putschiste » de rebaptiser l’aéroport de Conakry en « Aéroport international Ahmed Sékou Touré » : « Cet acte est complètement illégal. Le colonel Doumbouya n’a aucun pouvoir, aucune légalité, aucune légitimité pour baptiser ou débaptiser un lieu en République de Guinée. Colonel Doumbouya n’est pas un président de la République, c’est un putschiste. Il est là parce qu’il nous a débarrassés du régime néfaste d’Alpha Condé. On l’a applaudi pour cela. Mais, il n’a aucune légitimité, il n’est pas le président de la Guinée. » Retard à l’allumage ou regain tardif de lucidité pour appeler un chat un chat ? Tout lecteur attentif d’Amadou Kourouma aurait remarqué la forte ressemblance physique du lieutenant-colonel qui s’est emparé du pouvoir en Guinée non pas avec Thomas Sankara mais avec le maître-chasseur Koyaga, personnage principal d’En attendant le vote de bêtes sauvages (1998). De plus, les lunettes noires ont toujours été la marque déposée du général Eyadema, un autre putschiste qui a dédié 38 ans de pouvoir à nonchalamment restaurer l’ordre et la sécurité.
Enfin, arrêtons-nous brièvement sur l’analyse des réponses du régime président Roch Marc Kaboré à la crise sécuritaire qui frappe de plein fouet le Burkina Faso depuis 2015. Le pays des « hommes intègres », tout comme la Côte d’Ivoire, le Bénin ou le Togo, essuie des attaques de groupes armés originaires du Mali, notamment le Groupe de soutien de l’islam et des musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, et l’Organisation État islamique au Grand Sahara, qui ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelque deux millions de personnes. On estime aujourd’hui que plus de 40 % du territoire, du côté des frontières avec le Mali et le Niger, échappe au contrôle de Ouagadougou. Clairement, la crise sécuritaire n’est pas endogène au Burkina Faso et le pays comme la plupart des autres n’était nullement préparé à y faire face. Même si à la faveur de la contagion malienne et de l’émulation locale, un premier groupe djihadiste burkinabé, Ansaroul Islam, a émergé dans les régions frontalières. Dès le 14 mai 2019, pour se donner les moyens légaux d’agir avec moins d’entraves, la loi n°023-2019/AN, portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso, a été voté pour doter le pays de l’arsenal législatif « permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes » (article 10). Preuve s’il en fallait encore que confronté à la pire menace existentielle de l’histoire du Burkina Faso, le régime civil de Kaboré prenait pleinement la mesure de la situation et était déterminé à agir. Ironiquement, l’état d’urgence sera suspendu par le coup d’État du 24 janvier qui a mis un terme au régime de Roch Marc Christian Kaboré ; avant d’être restauré trois mois tard par décret, « afin de traquer les terroristes », selon les propres mots du ministre en charge de la Justice Barthélémy Kéré, dès avril 2022 par la junte alors dirigée par le colonel Damiba. Le 2 octobre 2022, le chef de la junte est à son tour poussé vers la sortie pour son manque de résultats dans la lutte contre les jihadistes. Tout ça pour ça ! Fallait-il ajouter une crise politique, en renversant le président démocratiquement élu, à une crise sécuritaire ? Ne fallait-il pas s’en tenir à la division constitutionnelle des tâches entre l’armée et l’exécutif ? Les militaires font la guerre et les politiciens gèrent l’État.
Singulièrement, les putschs à répétition au Mali et au Burkina Faso sont des réponses inopportunes à un dilemme sécuritaire qui ne va pas tarder à se poser à tous les pays voisins : les régimes de transition démocratique sont-ils en mesure de faire la guerre ou faut-il sacrifier à des régimes militaires nos précieux droits fondamentaux pour de pieuses promesses de sécurité ? Le double échec des militaires burkinabés aux affaires, à réinventer la roue (avec la restauration de l’état d’urgence après l’avoir suspendu) et à endiguer l’effritement du contrôle territorial, prouve que la légalité constitutionnelle n’est pas incompatible avec la conduite de la lutte contre le terrorisme dans un certain respect des droits et libertés. En revanche, cela apporte une confirmation : les putschistes burkinabés et maliens semblent payer en monnaie de singe la concession des libertés fondamentales consentie au nom de la sécurité. Au Mali, par ailleurs, le “Montesquieu en béret vert” vient de livrer la première mouture de son projet de révision constitutionnelle ; non content d’avoir transformé son pays en théâtre d’affrontement géopolitique pour mieux rajouter un écheveau supplémentaire de complexité à la crise de déliquescence qui frappe son pays, Assimi Goïta a décidé d’hyperprésidentialiser un régime dont le principal défaut n’était pas l’hypertrophie parlementariste. Tout ça pour ça ! Il faut rappeler que le colonel Assimi Goïta entend rester au pouvoir jusqu’en février 2024, à la demande des « forces vives de la nation » qui louent la double négation de « Monsieur Non » (« Non à la Cédéao, non aux sanctions ! »), pour réinventer de fond en comble la science constitutionnelle. Chapeau l’artiste !
Auparavant, c’était au nom d’une démocratie tropicalisée que les régimes militaires évidaient l’idéal démocratique de sa substance en Afrique francophone. Désormais, ils le font au nom de la sécurité avec le consentement tacite des populations et des activistes panafricanistes à la fois russophiles et sankaramanes. Pendant que la lumpenintelligentsia fournit des boucs émissaires pour défausser ces régimes de leurs responsabilités, les opinions publiques communient aveuglément dans des messes noires d’un anticolonialisme tardif et dans l’idolâtrie d’une icône d’un autre temps. L’afro-radicalisme est un radicalisme d’enfants gâtés dont l’impatience n’a d’égal que le rejet de tout ce qui frustre leurs passions tristes.
Radjoul Mouhamadou est doctorant en sciences politiques et chroniqueur à L’Echiquier.